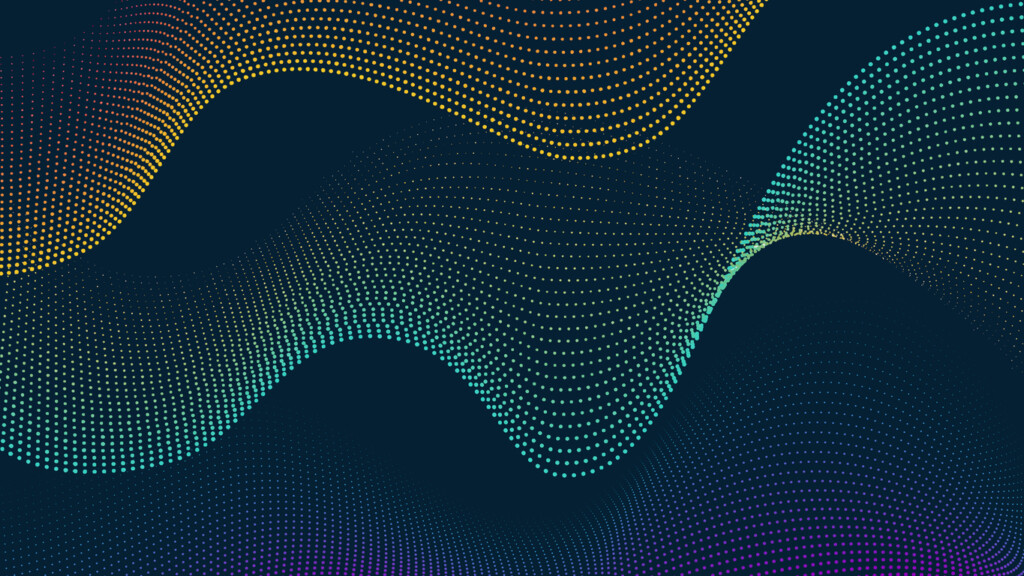Lors du Swiss Quantitative Investors Summit de cette année, organisé par BNP Paribas Global Markets au Château de Salavaux, à Neuchâtel, notre gérant de fonds Simon Lépine a rejoint Julien Turc, Head of QIS Lab chez BNP Paribas, pour une conversation approfondie intitulée « Une stratégie, plusieurs visages : décoder la dispersion actions ». Retrouvez les points clés de leur échange.
Repenser une stratégie mal comprise
Il y a à peine un an, beaucoup sur le marché étaient prêts à enterrer les stratégies de dispersion. « Au printemps 2024, le sentiment était très négatif », se souvient Julien. « Les corrélations implicites baissaient, et la presse financière était pleine de titres sceptiques. Mais malgré cela, nos indices ont remarquablement bien résisté. »
Julien a expliqué que la confusion vient en partie de la manière dont les investisseurs conçoivent les moteurs de la dispersion. « Beaucoup pensent que la corrélation est le facteur clé », a-t-il dit. « Mais historiquement, la dispersion est bien plus portée par la volatilité idiosyncratique. Lorsque la dispersion des rendements entre actions américaines est faible, nos données montrent qu’elle a souvent une marge pour s’élargir. »
Simon a confirmé, en ajoutant une perspective de praticien : « Le niveau de corrélation en soi ne dit pas grand-chose sur le PnL », a-t-il expliqué. « En pratique, la composition du panier compte beaucoup plus. La concentration du S&P dans les fameux Mag 7 a en réalité fait grimper la volatilité des actions individuelles tout en abaissant la corrélation globale. »
En d’autres termes, une faible corrélation implicite ne rend pas automatiquement la dispersion plus risquée, et une corrélation élevée n’est pas nécessairement plus sûre. Ce qui compte, c’est la façon dont la stratégie est construite.
La dispersion est-elle vraiment saturée ?
De la théorie à la pratique, la discussion s’est tournée vers la manière dont la dispersion est effectivement tradée aujourd’hui. « Plus d’investisseurs sont actifs dans la dispersion désormais », a observé Simon. « La forte performance observée en 2022 a attiré un mélange de pod shops et d’acteurs institutionnels traditionnels. Et les banques, dont BNP Paribas, l’ont rendue plus accessible grâce aux plateformes QIS. » Mais il a ajouté que cela a changé la façon d’implémenter la stratégie, et non les montants engagés.
« Les flux totaux n’ont pas vraiment augmenté », a-t-il dit. « Ils se sont simplement déplacés vers des implémentations plus simples, plus vanilla, alors que les structures plus complexes de volatility swaps ont eu du mal. »
Sur la volatilité individuelle, les flux liés à la dispersion restent bien plus modestes que ceux des programmes d’overwriting ou des produits de type reverse convertible. Côté indices, les flux restent surtout motivés par la demande de couverture, en particulier sur les maturités longues.
« Ce qui est important, c’est que les bons résultats récents viennent de gains réalisés, et non implicites », a ajouté Simon. « Cela me montre que les valorisations actuelles restent attractives. »
Choisir la bonne implémentation
Ils ont également abordé un point crucial souvent négligé : la manière dont la dispersion est mise en œuvre peut influencer la performance encore plus que le contexte de marché. « Historiquement, le vega-flat était la norme », a expliqué Julien. « Selon le QIS Lab, le gamma-flat est conceptuellement simple à comprendre. Il monétise la volatilité idiosyncratique et s’intègre bien dans un portefeuille, un peu comme acheter de la volatilité à bon prix. »
Simon a décrit comment les deux approches se comportent différemment : « Le gamma-flat est en fait un vega-flat avec une position longue en volatilité sur l’indice », a-t-il dit. « Il réduit automatiquement son exposition longue à la volatilité après un pic, ce qui agit comme un mécanisme naturel de prise de profit. »
Si le vega-flat présente une corrélation quasi nulle au marché et surperforme souvent à long terme, Simon voit de la valeur dans la combinaison des deux : « J’aime utiliser le gamma-flat sur les maturités courtes pour capter la dispersion réalisée, et le vega-flat sur les maturités longues pour monétiser la prime de corrélation », a-t-il expliqué. « Les combiner permet de s’adapter aux conditions de marché et aux besoins spécifiques d’un portefeuille. »
La dispersion : une boîte à outils, pas un modèle unique
Les deux intervenants s’accordent à dire que la dispersion doit être perçue non pas comme une stratégie unique, mais comme une boîte à outils offrant de multiples implémentations.
Quand vous tradez la dispersion listée, vous gérez souvent des milliers d’options, a souligné Simon
« Quand vous tradez la dispersion listée, vous gérez souvent des milliers d’options », a souligné Simon. « Il y a d’innombrables façons de la structurer – schémas de pondération, approches de couverture delta, sélection de titres – et cela rend la discipline de conception cruciale. »
Julien a ajouté : « Si votre panier de volatilité sur actions individuelles s’écarte du benchmark, vous faites en réalité du timing sur la stratégie. Cela peut bien fonctionner tant que vous contrôlez le bêta et la taille. À ce stade, cela ressemble davantage à une stratégie de long/short en volatilité actions. »
Si votre panier de volatilité sur actions individuelles s’écarte du benchmark, vous faites en réalité du timing sur la stratégie, partage Julien
Tous deux ont aussi souligné le défi des données limitées. Les options listées ont en général des maturités de six mois, ce qui crée seulement un court chevauchement historique par contrat, et l’historique exploitable ne couvre que 15 à 20 ans.
La précision avant le consensus
La discussion à Neuchâtel a montré que la dispersion n’est pas « terminée » : elle est simplement mal comprise. Elle n’est ni définie par la corrélation, ni condamnée par l’encombrement. Elle dépend de la manière dont elle est construite et gérée.
Comme Simon l’a résumé : « La dispersion est un domaine où chaque détail compte. Le succès dépend moins de la chasse aux signaux que de l’implémentation précise de la stratégie. »